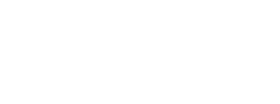Le séminaire éphémère du Lise
Le Séminaire éphémère du Lise est un espace mis à disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent réfléchir collectivement, dans le cadre du laboratoire, de la façon la plus libre possible.
Il est transversal aux différents axes et n’est pas soumis à une programmation annuelle.
Objectifs
Ce séminaire a pour buts de :
- Proposer lors de la venue d’un-e collègue de l'étranger de lui faire partager et discuter ses recherches
- Mettre en discussion un travail en cours
- Soumettre à la réflexion collective une difficulté particulière rencontrée en cours de recherche et qui semble d’intérêt commun
- Organiser un temps de dialogue avec d'autres membres et équipes du laboratoire autour de travaux qui peuvent se faire écho
- Instaurer un échange sur un thème entre des chercheurs et professionnels "experts" d’un sujet
- Se saisir d’une actualité, d’une question « sociale » forte pour la débattre scientifiquement avec un objet de recherche problématisé
- ...
Contact : anne.gillet@lecnam.net
Les entrées aux séminaires sont Libres et Gratuites
 Un accueil gourmand vous y attend !
Un accueil gourmand vous y attend ! 
Prochains séminaires internationaux
- Le mercredi 21 JANVIER 2026 de 14h à 16h, en salle 17 (1) 08. Accès 292, rue Saint-Martin, Paris 3ème
- Le lundi 09 FEVRIER 2026 de 14h à 16h
Accès Libre et Gratuit
Derniers séminaires éphémères internationaux
Vendredi 12 décembre 2025
Syndicalisme et travailleurs des plateformes numériques au Brésil et en France : précarisation du travail et organisation collective, avec Eduardo Rezende Pereira (Université de Campinas (Unicamp/Brésil)
L'objectif du séminaire est de discuter de l'action du syndicalisme brésilien et français avec les travailleurs des plateformes numériques, en vue de l'organisation collective et de l'accès aux droits. Le Brésil et la France se distinguent au niveau international en ce qui concerne l'expansion des services plateformisés et les formes de réglementation du travail (une troisième voie ou zone grise, située entre le salariat et l'informalité). À titre d'illustration, on estime qu'il y a environ 2,5 millions travailleurs de plateforme au Brésil contre 120 000 en France.
Cette réalité représente un défi pour le syndicalisme, qui rencontre des difficultés importantes pour organiser et représenter les intérêts collectifs de ces travailleurs, et négocier avec les mécanismes institutionnels face à l'avancée du néolibéralisme.
Le séminaire est présenté par Eduardo Rezende Pereira, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Campinas (Unicamp/Brésil). Il a effectué un stage de recherche au Laboratoire Triangle, basé à l'École Normale Supérieure (ENS) de Lyon, entre septembre 2024 et mars 2025. Ses projets de recherche et de vulgarisation sont liés aux thèmes de la précarisation du travail, des mouvements sociaux et du syndicalisme des travailleurs précaires, ainsi que des droits sociaux et du travail.
Eduardo Rezende Pereira a également publié le rapport du stage de recherche au Laboratoire Triangle, « Syndicalisme et travailleurs via applications mobiles en France : organisations, formes de syndicalisation et dialogue social » (traduit), en portugais.
La discussion est animée par Rémy Ponge (Maître de conférences en sociologie, Aix-Marseille Université - Institut Régional du Travail, Lest, membre associé au Lise).

Lundi 23 juin 2025
- Alex V. Barnard, Assistant professor of Sociology New-York University : « Consentement » et « Compliance » : la création des « sujets gouvernables » dans les interventions psychiatriques et judiciaires en France et aux États-Unis.
La prise en charge des maladies mentales sévères est fragmentée entre diverses institutions et professionnels. Comment ces intervenants coordonnent-ils leurs actions pour structurer les parcours des individus qu’ils accompagnent ? Cette étude analyse 300 audiences judiciaires à Paris et New York, où des patients hospitalisés sans consentement demandent à sortir. Plutôt qu’une simple alliance ou opposition entre juristes et médecins, elle montre une coordination minimale pour faire des patients des « sujets gouvernables » (Goffman). En France, l’objectif est un consentement minimal pour maintenir le lien médical, tandis qu’aux États-Unis, la priorité est la « compliance » médicamenteuse pour permettre la sortie. La « compliance » et le « consentement » répondent, d'une façon loin d'être idéale, aux exigences administratives et juridiques de ces deux contextes. Cette analyse nous invite à mieux cerner les différents types de coopération nécessaires entre acteurs (patients, usagers, justiciables) pour l'accomplissement du travail professionnel.
- Aude Lejeune, DR, CNRS, CERAPS : "La femme handicapée, une autre welfare queen. Genre et employabilité dans l’attribution des prestations sociales"
Dans un contexte d'incitation croissante au retour à l’emploi, comment les personnes en situation de handicap ont-elles accès à leurs droits sociaux ? À l'appui d'une enquête ethnographique au sein de plusieurs tribunaux français qui tranchent les affaires relatives à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ma présentation porte sur les logiques de détermination de l’employabilité et d’attribution des prestations sociales. Je montrerai que les femmes handicapées de classes populaires font - comme les femmes noires aux Etats-Unis perçues comme des profiteuses de l'Etat providence (welfare queens) - l’objet de plus de soupçons que les hommes lorsqu’elles cherchent à démontrer qu’elles ne sont pas employables sur le marché du travail.
- Ivan Garrec, postdoctorant (projet CISRA), IRIS - EHESS : À quoi sert une catégorie de santé mentale ? Enquête sur l’existence sociale du « trouble de la personnalité borderline » en France
Les catégories de santé mentale font actuellement l’objet d’une multitude de discours qui n’émanent pas seulement des dispositifs de soins. En effet, lorsqu’il s’agit d’évoquer certaines difficultés ou spécificités personnelles, ces catégories se retrouvent dans le champ médiatique, du côté des productions culturelles, ou encore au sein d’interactions sociales plus ordinaires. Comment comprendre la prééminence de ce langage psychologique ? Pourquoi nommer les difficultés et les spécificités individuelles avec ces catégories plutôt que d’autres ? Finalement, à quoi servent les catégories de santé mentale et pour qui ? Face à ce questionnement, cette présentation reviendra sur les principaux résultats d’une thèse de sociologie qui problématise l’existence sociale d’une catégorie de santé mentale genrée et contestée : le « trouble de la personnalité borderline ». Pour ce faire, elle éclairera les conditions de sa disponibilité dans l’espace social, les contextes dans lesquels elle circule, ainsi que les pratiques de catégorisation qui participent, concrètement, à la faire exister.
Discussion animée par Rémy Ponge (Maître de conférences en sociologie, Aix-Marseille Université - Institut Régional du Travail, Lest, membre associé au Lise).
Vendredi 20 juin 2025
Sur inscription : anne.gillet@lecnam.net
À rebours de l’exode rural qui la touche depuis près de deux siècles, la France voit depuis une vingtaine d’années des populations se déplacer, malgré elles, depuis les grandes villes vers les campagnes. Des hommes et des femmes en situation de précarité sont éloignés des métropoles où la gentrification les a rendus indésirables. Qui sont ces personnes ? D’où viennent-elles ? Pourquoi ont-elles été contraintes de se déplacer ?
En s’appuyant sur un travail de thèse mené pendant cinq années dans une petite ville de l’extrême périphérie de l’agglomération parisienne, Jean-Robert Dantou reviendra dans son intervention sur le rôle de la photographie documentaire dans une enquête en sciences sociales : À quelles conditions la photographie peut-elle prétendre constituer un outil scientifique ?
Cette séance propose ainsi un temps d'échange sur le travail de thèse de J.-R. Dantou, combinant création artistique et enquête socio-anthropologique.
Discussion animée par Corinne Gaudart (Directrice de recherche au CNRS et ergonome, Cnam, Lise-CNRS).
Mardi 08 Avril 2025
- La philosophe politique Nathalie Goldwaser Yankelevich (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET et Universidad Nacional de Avellaneda, Argentine) viendra discuter de son ouvrage :
La mode, une révolution éphémère (La moda, revolución efímera)
Elle nous a présenté comment le phénomène de la mode a été traité par la tradition sociologique, en particulier par la première école de Francfort.- La discussion est organisée par Guillaume Lecoeur (Historien et sociologue, docteur du Lise et chercheur associé au laboratoire HT2S) qui met en perspective les travaux de l'intervenante à partir de ses propres recherches en sociologie économique.
Vendredi 28 Mars 2025
Séance sur "Télétravail et nouvelles formes d'organisation du travail : formes, enjeux et effets"
- Diane-Gabrielle TREMBLAY (Professeure, Université Téluq, Québec-Canada) :
Télétravail, travail hybride et coworking : les nouveaux enjeux
La communication commencera par évoquer les réalités multiples du travail depuis la pandémie, soit le développement du travail hybride et du coworking, et surtout la progression du télétravail. Des données sur l’Importance quantitative du télétravail seront présentées et la communication abordera les enjeux principaux liés à ces transformations, soit les enjeux d’autonomie et de contrôle, de confiance, les risques de débordement sur la vie privée. On pourra aussi évoquer le fait que le télétravail s’est trouvé associé au développement des aires ouvertes de travail, où les salariés étaient d’abord obligés d’aller 2 jours par semaine mais de plus en plus 3 jours, et où se posent des enjeux de concentration et de nuisances sonores et visuelle. La communication repose sur des recherches menées au cours des trois dernières années, dans plusieurs milieux de travail diversifiés.
- Louis-Alexandre ERB (Dares - ministère du Travail, Erudite, TEPP-CNRS, France) :
Télétravail : quelles pratiques et quelles conditions de travail ? Une exploitation de l'enquête Tracov 2
Entre 2019 et 2023, la pratique du télétravail en France s’est fortement développée, passant de 9 % à 26 % des personnes salariées. Cette évolution a principalement bénéficié aux cadres, mais a aussi accru la présence en télétravail des femmes. Un tiers des salariés souhaitent télétravailler, notamment parmi les professions intermédiaires et la catégorie employée, bien que l’accès reste limité. Le télétravail améliore l’autonomie et réduit l'intensité du travail, mais réduit le soutien social. Il n’entraîne pas une répartition plus égalitaire du travail domestique, sauf en présence d'enfant(s) en bas âge. Enfin, les personnes en télétravail sont en moyenne en meilleure santé mais présentent un taux élevé de "présentéisme" surtout parmi les femmes.
- Discussion animée par Anne Gillet (Chargée de recherche en sociologie, Cnam, Lise-CNRS).
Accès Libre et Gratuit
Mardi 30 Avril 2024
Maurício Rombaldi : "Inégalités et relations de travail au Brésil : trajectoires sociales et précarité dans le Nordeste du pays"
Cette présentation fait référence à un projet de recherche en cours qui vise à comprendre les mécanismes matériels et symboliques de reproduction des inégalités sociales à travers les relations de travail au Brésil, à partir de l'analyse des trajectoires sociales qui font l'expérience de la précarité dans différentes zones et segments économiques de la région du Nord-Est du pays. La présentation examinera les travailleurs qui expérimentent des relations de travail précaires par le biais de l'informalité - une caractéristique historique du marché du travail au Brésil - en tenant compte, le cas échéant, de leurs intersections avec des activités de travail régulées. La recherche comporte une collecte de données statistiques mises à disposition par les organismes publics brésiliens, l'administration de questionnaires à des groupes de travailleurs et la réalisation d'entretiens en profondeur.
Modération : Maxime Quijoux (Sociologue et politiste, chargé de recherche au CNRS, Cnam, Lise-CNRS)
Maurício Rombaldi est professeur et vice-coordinateur du programme de post-graduation en sociologie de l'Université fédérale de Paraíba (UFPB) au Brésil, éditeur de la Revue brésilienne des sciences sociales (RBCS/ANPOCS). Il a été éditeur de la Revue Política e Trabalho (PPGS/UFPB) et membre de la direction de l'Association brésilienne des études sur le travail (ABET) pour l'exercice biennal 2022-2023. Il est docteur en sociologie de l'Université de São Paulo (USP). Sa ligne de recherche actuelle consiste à analyser les reconfigurations du monde du travail et leur relation avec la formation de dispositions sociales au milieu de trajectoires professionnelles instables. Parmi ses travaux figurent des études sur les secteurs des télécommunications, de la métallurgie et de la construction, analysant les implications des transformations dans les relations de travail, ainsi que la dynamique de l'internationalisation des syndicats au Brésil. Son expérience professionnelle antérieure comprend la coordination de projets pour des organismes syndicaux internationaux et la promotion des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Page de Maurício Rombaldi : http://lattes.cnpq.br/6381845842896121
lundi 18 Mars 2024

* Célia Forget : "La mobilité comme mode de vie. Ethnographie des vanlifers et full-timers"
La vie en camping-car ou en van attire un grand nombre de personnes, prêtes à tout quitter pour prendre la route. Au fil des 20 dernières années, mes enquêtes ethnographiques, menées principalement en Amérique du Nord, auprès de ces personnes ont démontré une évolution importante quant aux types d’adeptes et aux manières de faire. Crise économique, crise du logement et pandémie ont été des facteurs accentuant ce type de mode de vie. À travers ces enquêtes, j’ai été amenée à réfléchir plus largement au concept même de mobilité comme mode de vie, en anglais lifestyle mobilities, qui laisse entrevoir un nouveau champ de recherche que je vous invite à explorer.
Modération : Marine Loisy et Beatrice Zani
Célia Forget est professeure associée à l’Université du Québec à Montréal, coordonnatrice scientifique et chercheuse associée du Centre de recherche Cultures-Arts-Sociétés (CELAT). Docteure en anthropologie de l’Université Laval (Québec) et de l’Université de Provence (France), elle s’intéresse aux modes de vie mobiles, à l’immigration, au rapport à l’espace, aux enjeux de cohabitation et à l’esprit du lieu. Elle a publié en 2020 le numéro thématique « Modes de vie mobiles » de la revue Anthropologie et Sociétés.
* Table Ronde - Objets et Sujets en mouvement. Une réflexion autour des biographies, vies sociales et pratiques des acteurs des mobilités globales.
Lise/ Foap - Cnam/ MNHI.
Comment les objets construisent, accompagnent, font vivre et transforment les migrations et les mobilités ? Comment les biographies et les vies sociales des objets et des individus en déplacement se mélangent dans la fabrique d'expériences et pratiques de mouvement ? Quel est le rôle de la culture matérielle dans l'analyse des migrations et mobilités ? Dans quelle mesure l'agency des objets, leur capacité d'action, contribue-t-elle à produire et transformer les mondes sociaux, économiques, culturels et émotionnels traversés par les sujets en mouvement ?
Intervenantes : Hélène Bertheleu, Socio-anthropologue, professeure à l’Université de Tours ; Célia Forget, Anthropologue, professeure associée à l’UQAM ; Elisabeth Jolys-Shimells, Conservatrice en chef du patrimoine, cheffe du service des collections au Musée national de l’histoire de l’immigration ; Anne Raulin, Socio-anthropologue, professeure à Paris Nanterre.
Animation : Beatrice Zani, Chargée de recherche au CNRS, Lise.
Mardi 28 NOVEMBRE 2023
(Re)Building in a context/environment of vulnerability
1 - Ian Kaplan : "Education for girls and women in Afghanistan under the Taliban – glimmers of hope in the darkness"
More than two years into the Taliban re-exerting control over Afghanistan, the prospects for girl’s and women’s education in the country are increasingly grim: Secondary and tertiary education for females have been largely closed. Despite vague assurances that the ban is not permanent, there is no clear indication as to if, when, or how such education provision would reopen. Nevertheless, many communities across the country (and many Taliban themselves) are strongly in favour of female secondary and tertiary education and a few, limited, opportunities for Afghan girls and women still exist. My presentation looks at some of these opportunities and practices with focus on a network of ‘underground’ schools and a public school which continues to educate girls from ages 13-20. I will discuss the factors that enable such education practices to exist despite the extremely restrictive cultural and political context as well as what this means for some of Afghanistan’s female students and teachers. I will reference my research, which I have done through my work with an NGO – Norwegian Afghanistan Committee – which supports such initiatives.
Ian Kaplan has over 28 years of experience as a teacher, facilitator, university lecturer, researcher and education resource developer. His focus is on inclusion in education for those most marginalized, and he has worked on education with communities, NGOs, multilaterals and government ministries of education in Africa, the Balkans, Europe, the Middle East, South- and Southeast Asia. Ian has also been working to support governments in Afghanistan and Armenia in anti-corruption efforts. Ian currently works with the Norwegian Afghanistan Committee (NAC) as an education and research specialist and is also a director of the Enabling Education Network (EENET) – a global inclusion in education network of practitioners and researchers.
2 - Clément Bayetti : "Jugaad Psychiatry: The making of Indian Psychiatrists"
Over the past decade, the issue of the treatment gap and the shortage of available mental health professionals has become a significant public health concern in the Global South. In the case of India, this problem has been further complicated by a growing body of evidence that highlights a cultural divide between the practices of largely urban-based mental health professionals and the perception of suffering held by most of the Indian population. Yet, until recently very little was known about the training of Indian psychiatrists and the cultural construction of their professional identities, inclusive of how they practice, knowledge, and values are acquired, contested, resisted, sustained, and operationalized through their training and praxis. This talk will seek to address some of these questions by unpacking the results of 12-month of ethnographic work in a training institution located in a government psychiatric hospital in New Delhi, India. Through observation, interviews and focus group discussion, this presentation will show how Indian psychiatrists’ professional identities and practices are informed by more than their official curriculum and reflect the influence of other aspect of their identities, as well as that of several broader social changes and social actors, inclusive of the interest of the pharmaceutical industry. In doing so, it will reveal how the training of Indian psychiatrist ultimately results in a professional identity and praxis that embody a form of ‘Jugaad’ psychiatry characterized by the need to locally and culturally adapt a biomedical, evidence-based, approach to psychiatry to render it operationalizable in this context.
Clement Bayetti is a public health practitioner, medical anthropologist, and psychologist whose work and research interests span interdisciplinary approaches to exploring the intersection of system change approaches, community mental health program implementation and evaluation, and people- centered approaches to care. His research and teaching activities currently focus on several areas, including: the development of culturally and community-grounded definitions of mental health recovery and mental illness; medical socialization and the training of mental health professionals; and organizational change, social innovation and impact in third-sector organizations delivering community mental health services in the USA and India. Over the last decade, he has taught social workers, medical residents, and public health professionals on a range of topics associated with, public mental health, community mental health and program implementation and evaluation. In addition to his academic activities, he has worked internationally for almost two decades with third- sector organizations supporting people with psycho-social disabilities and communities to address system-wide behavioral health issues. He has collaborated with local and national organizations in the UK, India and the US to develop and implement mental health policy and services that are impact driven.
Animation : Anne Gillet
Mardi 21 NOVEMBRE 2023
 |
Nous accueillons Dr Isabelle Cockel, maîtresse de conférences en études sur l'Asie de l'Est et le développement international à l'Université de Portsmouth. |
'Super-mobility’ and translocality: Irregular workers and the informal farm labour market in rural Taiwan
This research is concerned with how small-scale family farmers in Taiwan recruit migrant workers who are either absconders from their legally contracted employment or visa overstayers whose employment is not legally permitted. Building on this concept of translocality, we propose a new concept of super-mobility that defines a situation where absconding guest workers are able to frequently take up casual employment in an informal labour market and increase their physical/geographical and occupational/economic mobility. The mobility regimes’ restrictions on their residency make them de facto single, living without the company of their family. As atomised human beings, they are free from the physical burden of caring for their family members, which is usually the cause of lower mobility. Because they are not governed by a legal contract, they are free from the mobility regimes’ surveillance of and limitation on their physical/geographical and occupational/economic mobility and are free to move frequently to wherever employment is available. Super-mobility is resourced by co-ethnic networking with the translocal migrant community and inter-ethnic networking with Taiwanese brokers and farmers, which develops over time (Baas and Yeoh, 2019). The cost of super-mobility relates to the prices paid for receiving employment information from nodes in the network, as well as for workers’ transport and accommodation. Super-mobility is by default made by the mobility regimes, but it clearly draws attention to the failure of regimes to use categorisation as a tool to regulate labour migration. Super-mobility is highly volatile and unstable, but it thrives on the vitality of translocality. However, that is also a fault, in that anyone who knows about super-mobility can easily cripple it by turning in an irregular worker to the state; the power to repatriate can terminate super-mobility.
This talk was discussed by Léonie Hemdat (Ph. D student, Lise).
Dr Isabelle Cockel is Senior Lecturer in East Asian and International Development Studies at the University of Portsmouth. Her research focuses on labour and marriage migration in East Asia. Exploring migrant labour in the care, agriculture and fishing industries, she is particularly interested in how the state instrumentalises migration for political economic interests and how migrant workers develop grassroots activism with the help of social media for their advocacy and campaign. Her publications focus on sovereignty, citizenship, gender, activism, and irregular work in the informal labour market. Enacting upon her commitment to academic activism, she utilises academic blogs to raise public awareness of inequality and injustice embedded in labour migration. She is currently the Secretary-General of the European Association of Taiwan Studies, Research Associate of Centre of Taiwan Studies of the School of Oriental and African Studies, and a Member on the European Advisory Board of European Research Centre on Contemporary Taiwan at the University of Tübingen. She is an Associate Editor of Asia Pacific Viewpoint and on the editorial board of International Journal of Taiwan Studies and International Journal of Asia Pacific Studies.
Vendredi 10 NOVEMBRE 2023
 |
Pietro Causarano, professeur invité au Cnam : Quand les syndicats découvrent la santé : travail, prévention et formation dans l’Italie des années 1970 |
Du point de vue de la prévention et de la gestion de la santé et de l’environnement au travail, les années 1970 marquent un tournant décisif pour l’Italie. La rupture de 1969 – connue sous le nom d’« automne chaud » – constitue la plus grande vague de conflits industriels de l’après-guerre, qui déferlera avec une intensité constante jusqu’au au milieu de la décennie suivante. Plusieurs changements vont se concrétiser dans le système des relations professionnelles, grâce à la puissance acquise par l’unité des grandes centrales syndicales et la mobilisation ouvrière. Forts de la décentralisation de la négociation au niveau de l’entreprise et de l’unité syndicale, ces travailleurs s’attachent à contester l’organisation de la production et les conditions de travail (rythmes, horaires, environnement, sécurité, etc.) en fabriquant un véritable « modèle syndical de la prévention ». La question de la santé et de la sécurité est ainsi abordée de façon nouvelle par rapport au passé du long après-guerre (l’époque de la « monétarisation du risque »). Ces questions seront également au centre d'un vaste processus d'auto-éducation de masse promu par les organisations syndicales et les délégués d'usine. L’expérience italienne des années 1970 sera d’exemple au niveau international, surtout européen et latino-américain.
Discussion animée par Léonie Hemdat (doctorante au Lise) et Ferruccio Ricciardi (chercheur au Lise).
Pietro Causarano est professeur à l’Université de Florence en Italie. Ses domaines de recherche sont l’histoire du travail et des cultures au travail, l’histoire sociale de l’éducation, l’histoire sociale du sport. Membre de la direction des revues « Passato e presente » et « Rivista di storia dell’educazione », il est aussi directeur de « A òpra. Annale di storia e studi sul lavoro ». Parmi ses publications plus récentes : Da un secolo all'altro: leggere il lavoro industriale. In: F. Loreto, G. Zazzara (a cura di), Fondato sul lavoro. Scritti per Stefano Musso, pp. 3-15, Torino: Academia University Press, 2022; Salute, prevenzione e formazione nell’esperienza dei sindacati industriali: il contributo femminile negli anni ’70. In: E. Betti, C. De Maria (a cura di). Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica. Spazi urbani e contesti industriali, pp. 55-74, Roma: BraDypUS, 2020; S. Bartolini, P. Causarano, S. Gallo (a cura di). Un altro 1969: i territori del conflitto in Italia, Palermo: NDF, 2020.